 |
Une dame sait qu'elle
va avoir un bébé parce qu'elle le sent en elle lorsqu'il bouge; et nous,
nous le voyons parce que cette dame devient bien grosse et qu'elle a souvent
l'air fatigué.
Avant sa naissance, le bébé se développe et se nourrit dans le corps de sa mère. La maman sait qu'elle va avoir bébé parce que le développement de l'enfant entraîne des modifications dans son organisme et, qu'en particulier, elle grossit en même temps que le futur nouveau-né. Cette période de grossesse fatigue la future mère, qui doit être l'objet de beaucoup d'attentions de la part de son entourage. |
| Avant de
naître nous étions une petite graine dans le corps de notre maman. Cette
graine a grossi, grandi jusqu'à ce qu'elle devienne un petit bébé.
Avant de naître, tout être vivant existe en puissance dans le corps de ceux qui deviendront ses parents. Deux sortes de cellules spécialisées, infiniment petites, sont en effet situées dans l'appareil génital de l'homme et de la femme, qui seront le père et la mère. Le rapprochement de ces deux cellules donne naissance à un œuf minuscule qui se développe dans le corps de la femme et qui devient au bout de neuf mois, le bébé attendu. |
|
 |
Parce que le bébé qui
va naître est très fragile. Il faut, les premiers jours, qu'il ait près
de lui un docteur et une infirmière qui le surveillent pour voir si le bébé
respire, mange et digère normalement.
La naissance d'un enfant est un phénomène naturel, mais qui n'est pas toujours exempt de risques pour la mère et pour l'enfant. À la maternité, la présence de médecins et de sage-femmes, qui connaissent parfaitement le processus de l'accouchement, réduit au minimum les accidents. La mère et le bébé sont placés dans de bonnes conditions d'hygiène qui minimisent les risques d'affection microbienne au cours de l'accouchement. |
| Quand le
fruit est mûr, il tombe de l'arbre. De même, lorsque le bébé est prêt, il
se sépare de sa maman et vient au monde.
Au bout de neuf mois de développement, des hormones hypophysaires, ovariennes et placentaires vont déclencher l'expulsion du nouveau-né. Le sac qui enveloppe l'enfant se rompt alors. L'enfant est à ce moment poussé vers l'extérieur. Il ne reste plus qu'à le recevoir dans les meilleures conditions possibles : c'est le travail du médecin ou de la sage femme. |
|
 |
Le bébé est ridé parce
qu'il est encore un peu maigre. Dès qu'il va grossir, son visage va prendre
de bonnes joues et ses rides disparaîtront.
Il arrive que les bébés soient ridés à la naissance. Le fait de naître constitue un ensemble de chocs pour le nouveau-né. Il vivait dans le liquide amniotique, respirant et se nourrissant aux dépens de sa mère. À la naissance, il doit déplisser ses poumons pour assurer ses premiers mouvements respiratoires. L'hydratation des cellules de la peau se fait dans des conditions nouvelles. Il lui faudra quelques jours pour s'adapter à son nouvel état, perdre ses « rides » et devenir le bébé lisse et rose que l'on aime admirer. |
| Les bébés
n'ont pas de dents à leur naissance par ce qu'elles n'ont pas encore poussé.
Elles se préparent dans les gencives et sortiront au bout de quelques mois,
les unes après les autres.
Lorsque le nouveau-né vient au monde, il possède, enfoui dans le derme, le bourgeon dentaire, contenant les cellules sécrétrices de l'émail et de l'ivoire, et le sac dentaire qui formera le cément. Mais il n'aura ses premières dents que vers six mois, et ne pourra auparavant, que se nourrir de lait maternel ou d'aliments liquides. Là encore, le jeune enfant a besoin des adultes pour survivre. |
|
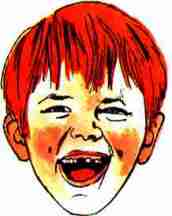 |
La première denture
est formée de petites dents à racine courte. Mais d'autres dents plus grosses
et plus fortes se préparent en dessous et apparaissent entre six et dix
ans. Quand elles sortent elles font tomber sans douleur les précédentes.
Les premières dents de l'enfant ou dents de lait tombent alors que la mâchoire est en train d'acquérir sa taille définitive. Les dents de remplacement de l'adulte durent jusqu'à la fin de la vie et sont plus grandes que les premières dents de la petite enfance. |
| Parce
que leurs jambes n'ont pas encore assez de force. Le petit bébé doit d'abord
apprendre à se tenir assis, puis à se tenir debout et enfin il marchera.
A la naissance, le bébé possède tous les organes nécessaires à la vie. Mais c'est surtout un tube digestif doublé d'un système nerveux qui fonctionne : bébé entend, crie, et a même, en vain, le réflexe de la marche. Les spécialistes ne savent pas exactement pourquoi le nouveau-né humain est le moins doué du règne animal. On le dit « immaturé » pour marquer cette fragilité, cette incapacité de trouver seul sa nourriture, qui le mettent sous l'indépendance totale de sa mère et des adultes. |
|
 |
La « petite graine »
qui se transforme en bébé dans le ventre de la maman est rattachée à celle-ci
par un tube, ou cordon ombilical. À la naissance, on coupe le cordon. Le
nombril, ou ombilic, est la cicatrice de cette petite coupure.
Dans le ventre maternel, le bébé est nourri par les substances contenues dans le sang de la mère. Ce sang parvient à l'enfant par l'intermédiaire du « sac » dans lequel il repose, le placenta, auquel le bébé est lié par le cordon ombilical. La naissance entraîne l'expulsion du cordon et du placenta. Le médecin tranche ce dernier lien, et marque ainsi l'autonomie de l'enfant. Le cordon laisse une cicatrice profonde et indélébile sur l'abdomen. |
| Parce
que notre colonne vertébrale se termine en bas du dos, tandis que chez les
animaux elle se prolonge, formant ainsi une queue plus ou moins longue.
L'étude comparée des fossiles permet de conclure que les espèces ont évolué en se perfectionnant, en s'adaptant aux variations du milieu. L'enquête anatomique montre que des organes, devenus inutiles, se sont atrophies ou ont disparu. La queue participe à l'équilibre et à la locomotion chez les quadrupèdes. L'homme, bipède, adapté à la station verticale, ne possède plus qu'une queue rudimentaire (les vertèbres caudales ou coccyx), qui a perdu son rôle initial. |
|
 |
Les jeunes bébés tètent
le lait de leur maman ou celui d'un biberon afin de se nourrir et pour pouvoir
grandir et grossir. Aucune nourriture ne leur convient mieux.
Le lait maternel contient en qualité et en quantité les aliments les mieux adaptés à l'organisme du nouveau-né, vitamines C. et fer par exemple, diastases et substances immunisantes également. Consommé à l'état naissant, il est toujours à la température du corps et limite les dangers d'infection microbienne. De plus, la tétée est un lien intime entre la mère et l'enfant et un élément important de l'équilibre affectif du bébé. |
| On grandit
encore longtemps après la naissance, pour ne pas rester un enfant, mais
pour devenir un adulte qui aura des enfants, un métier et des responsabilités.
En grandissant, on devient plus fort et plus sage.
Pendant l'enfance, une partie des aliments sert à construire les cellules qui permettent de grandir. Cette fonction ne peut s'accomplir sans l'activité des glandes endocrines sécrétant des hormones qui agissent à doses infimes. La glande thyroïde, logée à la base du larynx, et l'hypophyse, située dans le cerveau, produisent chacune une hormone de croissance, qui agit sur l'ossification jusqu'à l'obtention de la taille adulte. |
|
 |
Nos yeux sont toujours
mouillés par des larmes venant d'un petit sac situé sous la paupière supérieure.
Quand nous avons du chagrin, l'émotion en fait sortir tellement de larmes,
qu'elles coulent sur le visage.
Une mauvaise nouvelle, une douleur, une contrariété déclenchent un ensemble de réactions émotionnelles. Des réflexes élaborés par les noyaux gris centraux du cerveau, provoquent l'émission de larmes, souvent accompagnées de cris et de tremblements. Une autre région du cerveau, le cortex, siège de la volonté, permet de contrôler les manifestations de la souffrance. On sait enfin que la fatigue nerveuse provoque également des crises de larmes. |
| Les cris
ou les paroles sortent de notre bouche grâce aux cordes vocales qui sont
dans notre gorge. Elles vibrent comme les cordes d'un violon ou celles d'une
guitare.
Lorsque la matière vibre, les oscillations produites à une fréquence convenable donnent naissance à un son. Le larynx contient des replis membraneux, les cordes vocales, limitant deux minces fentes traversées par l'air expiré venant des poumons. La tension, l'épaisseur de ses cordes vocales peut varier sous l'action de fibres musculaires reliées au système nerveux. L'air expiré fait vibrer ses cordes vocales à des fréquences variables et produit des sons différents, que la bouche module. |
|
 |
Cette expression amusante
signifie : avoir dans la gorge quelque chose qui gêne pour parler et transforme
brusquement la voix en une sorte de miaulement.
C'est une plaisanterie que l'on fait lorsqu'un enrouement brusque empêche de parler d'une voix normale. Les sons émis son rauques, manquent de l'intensité habituelle, et rappellent le miaulement du chat. Ce n'est souvent qu'une mucosité qu'un toussotement suffit à évacuer. |
| À qui ne
sait pas répondre à une question la langue ne sert plus à rien. Alors on
dit : « je donne ma langue au chat » comme on jette au chat le morceau de
viande qui reste quand on n'a plus faim.
On disait primitivement : « donner sa langue aux chiens », par adaptation d'une expression venue des religions égyptienne et grecque. L'origine est liée au sphinx, animal fabuleux à tête humaine et corps de lion, qui passait pour être capable de poser des problèmes d'une grande difficulté ou des énigmes impénétrables. |
|
 |
Pour être musicien ou
chanteur il faut avoir une ouïe fine et sensible. Il faut pouvoir reconnaître
les notes jouées et distinguer les notes justes des notes fausses. C'est
un don naturel. Tout le monde a deux oreilles mais pas forcément « de l'oreille
».
Cette expression s'applique à une personne particulièrement sensible à la musique, et qui semble apte à reproduire des sons musicaux avec justesse et facilité, soit en chantant soit en jouant d'un instrument de musique. |
| Lorsque le
tympan de notre oreille est soumis à des bruits trop violents et répétés
nous ont l'impression qu'il va se rompre. Aussi dit-on à une personne qui
parle trop, qui s'exprime très fort ou qui répète toujours la même chose
: « vous me cassez les oreilles. »
Une personne envahissante et bavarde finit, avec ses flots de paroles, par irriter son interlocuteur. Celui-ci voudrait ne plus entendre cette voix désagréable qui provoque une irritation physique et morale. |
|
 |
L'oreille apprécie la
musique, les sons doux et harmonieux, les lignes mélodiques des chansons
et les accords de l'orchestre. Les bruits sont déplaisants parce qu'ils
sont violents, souvent inattendus, laids ou faux et qu'ils font souffrir
l'oreille.
Dans l'Antiquité, le même mot désignait la musique et l'acoustique. Il est effectivement malaisé de tracer une démarcation entre les sons musicaux et les autres. Un bruit et un mélange de sons discordants que l'on subit, et dont la puissance provoque une sensation de douleur. L'impression agréable produite par la musique provient de ce que les sons sont utilisés selon des règles définies par les lois de l'harmonie. |
| Pour atteindre
la taille d'homme, il faut vingt ans environ. Cela fait si peu, si peu à
chaque jour que l'enfant ne peut s'en apercevoir. Mais il s'en rend compte,
quand il constate que ses vêtements, sont devenus trop petits.
Il arrive qu'on se sente grandir. On éprouve alors des douleurs dans les articulations, voire une fatigue passagère. Mais, en général, l'accroissement de la taille est un phénomène si naturel, si lent et si progressif, que le squelette et les muscles s'accroissent sans qu'il soit possible de s'en rendre compte. |
|
 |
Il faut manger parce
que notre corps a besoin de nourriture pour vivre. Si nous ne mangions pas,
nous n'aurions plus de force et nous tomberions rapidement malades.
Les aliments sont oxydés dans l'organisme et apportent l'énergie nécessaire au fonctionnement ininterrompu des muscles respiratoires, du cœur, de l'appareil digestif, à la sécrétion des glandes, etc. Toute activité physique ou intellectuelle accroît la consommation d'énergie. Un homme a besoin de 2400 à 6000 calories par jour, selon la nature du travail effectué. La ration alimentaire varie aussi selon la température extérieure et l'état psychologique de l'individu. |
| On bâille
quand on a faim ou bien quand on a sommeil. On bâille aussi quand on s'ennuie.
Bâiller, c'est aspirer beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène qui revivifie
le corps. Mais cela ne doit pas empêcher les gens qui bâillent, naturellement,
de mettre leur main devant la bouche.
Le bâillement est un mouvement réflexe qui se produit en cas de mauvaise digestion, de fatigue ou d'ennui. Il semble que le fait de bâiller et d'aspirer, par une respiration prolongée, une grande quantité d'air, active l'oxygénation du sang et redonne un coup de fouet provisoire à l'organisme fatigué. |
|
 |
L'estomac est une poche
qu'on ne sent pas, en temps normal. Si on mange trop, qui devient pesant.
Au contraire, quand on a faim, on sent le vide de l'estomac et si on est
vraiment affamé, ce creux à l'air de tellement s'agrandir qu'il semble envahir
tout le corps jusqu'aux talons.
Lorsqu'on a faim, il semble que les contractions de l'estomac deviennent perceptibles. On éprouve une certaine gêne, une vague sensation de douleur. L'imagination pousse à inventer un réceptacle agrandi démesurément, jusqu'aux extrémités inférieures du corps humain. |
 |
L'autruche peut avaler
des cailloux et des morceaux de fer sans être incommodée. Certaines personnes
voraces peuvent absorber des quantités d'aliments lourds sans souffrir de
l'estomac. Alors on dit avec un peu de jalousie qu'elles ont un estomac
d'autruche.
L'autruche se nourrit essentiellement de végétaux, mais elle est vorace et elle agrémente volontiers son menu en y ajoutant des insectes et des reptiles. En captivité elle avale les objets les plus variés, pierres, ferrailles diverses, son estomac étant constitué de muscles extrêmement puissants. Un individu capable d'avaler une grande quantité anormale de nourriture, plus gourmand que gourmet, est censé posséder un estomac d'autruche. |
| Nous
allons nous coucher tous les soirs parce que notre corps fatigué a besoin
de se reposer. Pendant le sommeil nous reprenons des forces pour recommencer
à travailler le lendemain.
Toute activité physique ou musculaire produit de la fatigue. Cela signifie qu'il y a épuisement progressif des substances nécessaires au fonctionnement organique, et accumulation de déchets dont les effets se font sentir dans les muscles et le système nerveux. Pendant le sommeil, l'organisme, moins sollicité par les phénomènes extérieurs, va retrouver équilibre et détente pour être prêt à de nouvelles dépenses d'énergie. |
|
 |
Le sommeil provoque
un relâchement général des muscles. Le muscle qui maintient la paupière
ouverte se détend ; la paupière s'abaisse alors sur l'œil et le ferme.
Pendant le sommeil, le cerveau cesse d'être fonctionnel. Les activités organiques sont ralenties. Certains muscles se relâchent. C'est le relâchement du muscle releveur des paupières qui fait tout naturellement fermer les yeux lorsqu'on dort. |
| Comme
un bijou dans son écrin, l'œil est placé dans une cavité de notre crâne,
appelée orbite, et dont les paupières sont le couvercle. En outre, l'œil
est attaché aux autres parties de notre tête par de nombreux muscles qui
le font tourner dans tous les sens.
L'œil est enfoncé aux deux tiers dans une cavité osseuse pyramidale de la boîte crânienne, l'orbite, percée d'un certain nombre d'orifices pour le passage des nerfs et des vaisseaux. La mobilité de l'œil est assurée par six muscles insérés sur la paroi orbitale. Enfin, le globe oculaire est recouvert, à l'avant, par le diaphragme des paupières. |
|
 |
Alors que le chien et
le chat semblent dormir profondément, ils se réveillent au moindre bruit
suspect. Ce qui permettrait de croire qu'ils conservent toujours un œil
ouvert. De même une personne préoccupée peut se réveiller très facilement,
comme si elle n'était qu'à demi endormie.
Il arrive qu'à la suite d'une préoccupation, d'une grande fatigue, le système nerveux ne trouve pas le moyen d'arriver à une détente totale jusqu'au sommeil profond. Le moindre bruit suffit alors à réveiller le dormeur, qui passe de l'état de veille à la pleine conscience, très rapidement. |
| Quand on
n'a pas de mètre pour mesurer une distance ou qu'on n'a pas le temps d'apprécier
une grandeur on évalue l'une ou l'autre sans précision. C'est une question
de flair. Avec un peu d'habitude l'estimation peut être à peu près juste.
Il s'agit d'une estimation approximative ou d'un jugement sans profondeur, hâtif, formulé avec légèreté, sans avoir pris la peine d'accumuler des informations précises ou de réfléchir pour tirer une conclusion. |
|
 |
Nous rêvons parce que
notre cerveau n'est jamais en repos complet même quand nous dormons. Le
souvenir des événements de la journée revient à notre esprit et forme des
images parfois bizarres qui nous étonnent ou nous effraient.
L'étude des rêves est devenue science à une époque récente. L'électroencéphalogramme, qui transcrit les variations de l'activité électrique du cerveau, a permis de conclure que tout le monde rêve, même les bébés, chaque nuit, et même à heure fixe. Mais la mémoire ne garde qu'un souvenir imprécis ou inexistant de cette activité onirique. Il semble que rêver soit un phénomène naturel, encore mal connu, mais indispensable à notre équilibre psychique. |
| La chaleur
du corps est la conséquence de la respiration. Plus nous courons longtemps,
plus nous respirons vite, plus nous avons chaud, et... plus nous transpirons.
La transpiration nous rafraîchit, mais gare au chaud et froid !
L'effort produit par les muscles pendant la course, provoque une augmentation de la consommation d'énergie dans l'organisme. Le cœur bat plus vite, l'oxygénation du sang est accélérée, les oxydations sont plus rapides. Il y a augmentation de la production de chaleur. On a chaud, et en même temps on transpire pour rétablir l'équilibre thermique interne perturbé. |
|
 |
Il ne faut pas croire
que la laine chauffe notre corps. Elle empêche seulement notre chaleur de
s'échapper et le froid extérieur de pénétrer jusqu'à notre corps. Un vêtement
de laine tient chaud : les moutons le savent bien !
Les filaments ondulés des fibres de laine sont fait d'écailles imbriquées. La couche d'air accumulée entre la peau et le vêtement s'échauffe au contact du corps. Les écailles du tissu de laine retiennent ce matelas d'air chaud, qui ralentit les échanges thermiques avec l'air extérieur et évite les déperditions de la chaleur du corps. La laine est donc un excellent isolant thermique. |
| On emploie
cette expression lorsque l'on oublie brusquement un mot que l'on était sur
le point de prononcer et que l'on ne retrouve plus, tout en le sentant très
proche et comme sur le bout de la langue, prêt à sortir.
Il arrive qu'on ait quelque peine à retrouver un mot connu ou une expression familière par un trouble passager de la mémoire, le mot ou l'expression paraissant cependant prêts à passer les lèvres, comme si une force quelconque les retenait au bout de la langue. |
|
 |
Ce sont les nerfs de
notre corps qui nous transmettent la douleur, quand on se coupe ou quand
on se brûle. Comme il n'y a pas de nerfs dans nos ongles ou nos cheveux,
on ne souffre pas lorsqu'on les coupe.
Les ongles et les cheveux, élaborés par des cellules incluses plus ou moins profondément dans la peau, possèdent à leur base des terminaisons nerveuses. Mais celles-ci ne se ramifient pas dans le poil. C'est pourquoi l'action de couper les cheveux ou les ongles ne fait pas mal. Par contre, si on arrache un cheveu ou un ongle, les nerfs de la base sont lésés et l'on ressent une vive douleur. |
| Parce que
les cheveux qu'ils avaient sont tombés petit à petit et qu'ils sont ainsi
devenus chauves. L'âge ou la maladie font tomber les cheveux. Il y a plus
d'hommes chauves que de femmes chauves : soignent-elles mieux leur chevelure
?
Avec l'âge, l'involution de l'organisme conduit à la pendant un calvitie sénile, par oblitération des artérioles qui nourrissent les bulbes pileux. Mais on peut devenir chauve prématurément, à l'occasion d'affections diverses. Souvent, la sécrétion excessive des glandes sudoripares et sébacées provoque une séborrhée, qui entraîne la chute des cheveux. |
|
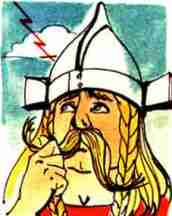 |
Les hommes qui ne se
rasent pas tous les matins voient apparaître des poils qui s'allongent chaque
jour, formant au-dessus de leur bouche une moustache et autour de leur menton
une barbe.
La moustache est un des caractères secondaires qui marquent la différence des sexes. Le système pileux de l'homme est plus développé que celui de la femme. C'est une hormone, ont la testostérone, qui détermine l'abondance de la barbe et de la moustache chez l'homme. Bien sûr, ont le port d'une moustache abondante est lié aux modes, aux coutumes d'un pays. |
| Les paupières
s'abaissent et se relèvent pour protéger les yeux contre une très forte
lumière, contre les poussières qui volent, mais aussi pour les maintenir
humides. Si une poussière ou un insecte s'introduit dans l'œil, les
battements des paupières augmentent, et des larmes emplissent l'œil.
Les paupières sont des organes protecteurs. Par leurs mouvements, réflexes ou volontaires, elles permettent aux cils d'arrêter une partie des poussières ou des corps étrangers qui viennent frapper l'œil. Ces mêmes mouvements répartissent les larmes sur la cornée, ce qui assure l'élimination des fines particules colorées sur le globe oculaire, et la transparence de la cornée, indispensable pour une vision correcte. |
|
 |
Quand on se trouve en
un point élevé et dominant le vide on est pris de vertige parce que la peur
du vide nous donne l'impression d'un manque d'équilibre. On s'imagine qu'on
va tomber.
Les organes vestibulaires de l'oreille participent, en même temps que la vue et le toucher, au sens se de l'équilibration. Lorsqu'il s'agit de mouvements naturels, les informations reçues par le cerveau sont concordantes. Il arrive, par contre, que les réflexes jouent plus difficilement dans des situations inhabituelles. Par le canal de différents nerfs, le cerveau reçoit des indications contradictoires, difficiles à interpréter et qui provoquent les troubles de l'équilibre et le vertige. |
| Notre corps
contient des muscles. Ce sont eux qui travaillent lorsque le bras porte
un sac. Le muscle qui travaille se resserre et durcit. Au repos, il se détend
et redevient très souple. Les sportifs ont des muscles très développés.
Le biceps est un muscle long divisé à l'extrémité supérieure en deux masses qui s'insèrent sur l'omoplate pas, l'extrémité inférieure est rattachée par un tendon au radius. L'ensemble, muscle et os, fonctionne comme un levier. Lorsqu'il faut soulever une charge, le donc s'opposer à la pesanteur, les fibres musculaires se contractent grâce à leur structure orientée, et le muscle devient dur. |
|
 |
Autrefois pour coudre
les vêtements, les tailleurs avaient l'habitude de travailler assis sur
leur table, les jambes croisées et repliées sous eux. Aussi lorsque quelqu'un
s'assoit de la même façon sur le sol, on dit qu'il est « assis en tailleur
».
Dans l'Antiquité, et à une époque récente, dans les pays d'Orient ou d'Afrique, les artisans travaillaient volontiers assis sur le sol, les jambes repliées et croisées ; cette station donne un certain équilibre et permet le travail manuel. |
| En prenant
une mauvaise position, on comprime les veines et les artères de la jambe
et cela empêche le sang de bien circuler. Au moment où la circulation se
rétablit, le « changement de vitesse » provoque ces petits chatouillements
désagréables comme si des quantités de fourmis vous couraient sur les pieds.
Il arrive qu'une mauvaise position des jambes provoque la compression de veines et de capillaires. Le rythme de l'irrigation sanguine est perturbé. Il y a surpression au niveau de la compression, puis dépression quand la compression cesse. Tant que l'équilibre de la circulation du sang dans les extrémités des jambes n'est pas rétabli, on ressent ces picotements gênants appelés encore fourmillements. |
|
 |
À mesure qu'elle vieillissent
les personnes âgées perdent leur force. Leurs cheveux s'affaiblissent, ils
se décolorent ils deviennent gris, puis blancs, souvent même ils se détachent
et tombent comme les feuilles des arbres à l'automne.
La coloration des cheveux est due à la présence d'un pigment, La mélanine, qui colore également la peau. Les cheveux blancs révèlent une absence de mélanine et participent au phénomène d'involution de l'organisme, mais les gens jeunes peuvent avoir des cheveux blancs. On pense que cette décoloration est liée au métabolisme du cuivre ou à la présence de bulles d'air très fines qui est obstrueraient le poil et empêcheraient la pigmentation. |
| La peau des
vieillards n'a plus la même vitalité que celle des jeunes et des bébés.
Elle se fripe et se ride comme le font les pommes qui se dessèchent en vieillissant.
Mais certaines rides sont des plis du visage, même chez les jeunes.
Les cellules de la peau perdent une partie de leur eau par élimination des déchets : c'est la sueur. Chez un être jeune, cette eau est remplacée au fur et à mesure. Chez une personne âgée, le volume d'eau fourni aux cellules par l'organisme est inférieur au volume éliminé. La cellule se vide, donc se rétracte. On appelle cela la plasmolyse. La rétraction des cellules fait que la peau n'est plus tendue. Il y a formation de rides. |
|
 |
Notre peau contient un
« pigment » qui la colore. S'il y en a plus à certains endroits qu'à d'autres,
cela fait des tâches. Quand la peau reste longtemps exposée au soleil, ce
pigment se développe et les tâches sont plus apparentes et plus nombreuses.
Les taches de rousseur, aussi appelées éphélides, se développent plus volontiers sur les peaux fragiles des individus roux, blonds ou châtains, et envahissent la face, le cou et les mains. La peau contient un pigment, la mélanine, qui colore également les cheveux, et qui s'accumule dans le tissu sous-cutané pour former ces taches brunes, en réaction de défense contre les radiations solaires. |
| Le vieillard
se courbe parce qu'il est très âgé. Son corps fatigué ne peut plus se tenir
droit. Il penche en avant et s'appuie souvent sur une canne.
Avec l'âge, il y a une involution de tout l'organisme. Le tonus musculaire diminue pas, les vertèbres se déforment, perdent de leur hauteur ; les disques cartilagineux intervertébraux se tassent. Si ce tassement se fait d'une manière irrégulière, la partie antérieure des vertèbres s'affaisse plus que la partie postérieure. La colonne se voûte : c'est la cyphose des vieillards. |
|