 |
Certainement, mais il y a tellement, tellement longtemps, et il y a eu tellement de changements depuis, qu'on ne sait pas encore très bien comment cela s'est passé. Les techniques modernes, appliquées à la géologie, permettent de penser que la terre existe depuis plusieurs milliards d'années. Il semble que la vie soit apparue il y a un milliard d'années seulement, sous forme de végétaux et d'animaux inférieurs, retrouvés fossilisés dans les roches, et qui ont évolué en se perfectionnant, jusqu'aux espèces actuelles. L'apparition de l'homme est récente : les squelettes humains les plus vieux n'auraient pas plus de 600.000 à un million d'années. |
| Oui, on voit
le soleil dans tous les pays mais pas en même temps. La terre est semblable
à un immense manège qui tourne devant un lampadaire qui est le soleil. Chaque
pays à son tour reçoit la lumière et chaque pays à son tour entre dans la
nuit.
La terre tourne sur elle-même en 24 heures, donc, de tous les points du globe, on voit le soleil. Cependant, comme l'axe de rotation est incliné, le 21 juin pour les points situés entre le pôle Sud et le cercle polaire Sud, sont plongés dans la nuit. Il en est de même le 21 décembre pour tous les points situés entre le pôle Nord et le cercle polaire Nord. De ces lieux particuliers, il arrive donc que l'on ne puisse pas voir le soleil. |
|
 |
L'heure est donnée par
la position du soleil. Comme la terre tourne, les pays passent l'un après
l'autre devant le soleil. Quand le soleil se lève en France il y a longtemps
que les Russes l'ont vu se lever et les Américains sont encore dans la nuit.
Il est midi vrai en un lieu, lorsque le soleil est au plus haut de sa course en ce point, c'est-à-dire lorsqu'il passe au méridien du lieu. Tous les points situés sur un même méridien ont la même heure. Par commodité, on a divisé la terre en 24 fuseaux horaires, limités chacun par deux méridiens distants de 15 degrés. À l'intérieur d'un fuseau, tous les lieux ont la même heure, qui est l'heure vraie du méridien qui passe au milieu du fuseau. |
| La Lune tourne
autour de la Terre en 28 jours environ et pendant ce temps, elle se montre
sous quatre aspects différents : nouvelle lune, premier quartier, pleine
lune et dernier quartier. En divisant 28 par 4, on obtient 7 jours, ou une
semaine.
La division de la semaine en sept jours nous vient des chaldéens. Les hébreux ajoutèrent à cette division une signification mystique, les six premiers jours étant liés à la création du monde et le septième au repos où Sabbat. À Rome, sous l'empereur Auguste, la semaine est définitivement adoptée et chaque jour consacré à une divinité, dont on retrouve les noms, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne dans les appellations des jours actuels. Le dimanche est le jour du soleil, consacré a Dieu dans les rites chrétiens. |
|
 |
Il faut un an à la Terre
pour faire le tour complet du Soleil. Pendant ce temps, la Lune faite douze
fois le tour de la Terre. Le moins correspond, à peu près, à la durée de
chaque jour. Le calendrier a été établi pour tenir compte de tout cela.
Bien avant notre ère, les Babyloniens, prirent comme unité de temps la période qui s'écoule entre deux nouvelles lunes, et comptèrent en « lunes » ou mois. Mais les saisons sont régies par le mouvement de la Terre autour du Soleil. Il fallut bien des remaniements, au cours de l'histoire, pour établir un calendrier qui coïncide avec les saisons. La durée actuelle de nos mois n'a plus grand-chose à voir avec la durée d'une lunaison. |
| Parce que
ce serait le jour ! Car la terre tourne sur elle-même comme une grosse toupie.
Le soleil n'en éclaire qu'une partie à la fois : dans cette partie c'est
le jour, de l'autre côté c'est la nuit.
La terre tourne sur elle-même en 24 heures. Au cours de cette rotation, chaque point du globe reçoit la lumière du soleil pendant un temps variable : c'est le jour. La nuit est précisément la période pendante laquelle une partie de la terre se trouve dans la zone non éclairée, et pendant laquelle on ne peut pas voir le soleil. |
|
 |
Parmi les rayons qui
composent la lumière du soleil, les rayons « ultraviolets » sont les plus
dangereux. Ils provoquent des coups de soleil sur la peau et risqueraient
d'abîmer le fond de l'œil, si des verres colorés ne les empêchaient
pas de passer.
Une lumière trop intense, aussi bien que les radiations ultraviolettes émises par le soleil, risquent d'avoir des effets biologiques désastreux sur la rétine. Les lunettes le soleil constituent un écran protecteur. Elles ne sont pas noires, sinon aucune radiations lumineuse ne les traverserait. Elles sont faites d'un verre coloré, plus ou moins foncé qui absorbe une partie les radiations solaires. |
| Le vent
est de l'air qui se déplace tout seul plus ou moins vite parce qu'en un
endroit de l'air chaud léger s'envole qu'aussitôt de l'air froid vient prendre
sa place, faisant un grand courant d'air.
La température, à la surface du globe, n'est pas uniforme. L'air chaud se dilate, devient plus léger, et s'élève en repoussant les masses d'air plus froides des couches supérieures de l'atmosphère. Parallèlement, l'air froid remplit l'espace vide ainsi créé. L'ensemble de l'atmosphère et donc parcouru par d'énormes courants d'air, appelés vents. Ceux-ci, sporadiques ou réguliers, dépendent des variations saisonnières de température journalière, et de leur situation géographique. |
|
 |
Pour indiquer la direction
des vents on a dessiné sur un cadran une sorte de rosace dont les flèches
rayonnent autour du centre comme les pétales d'une rose. Mais ce dessin
ne ressemble guère à une rose.
Sur le compas de marine, la boussole est associée à un disque mobile portant des divisions égales semblables aux pétales d'une rose. La rose des vents fut divisée d'abord par les Grecs selon la direction des quatre vents cardinaux et de quatre vents collatéraux soufflant dans des directions intermédiaires. Les Romains ajoutèrent 20 autres directions de vents collatéraux. À partir du XVIII e siècle et jusqu'à une époque récente, la rose des vents comportait 32 aires de vents ou rhumbs. |
| Le vent n'est
pas fait par les arbres. Si l'air qui souffle fort à travers les branches
qui fait bouger les feuilles et balancer l'arbre.
Ce ne sont pas les arbres qui donnent naissance aux vent. Ceux-ci sont le résultat de différences de température entre les diverses couches d'air de l'atmosphère, entraînant l'air chaud dans un mouvement ascensionnel, alors que l'air froid descend et comble immédiatement le vide ainsi amorcé. Le vent agite les arbres, et permet de prendre conscience du déplacement des masses d'air atmosphérique. |
|
 |
C'est toujours le vent
qui les pousse et les emporte. Si nous nous sentons pas de vent à l'endroit
où nous sommes, cela prouve qu'il souffle seulement plus haut, à hauteur
des nuages.
Les nuages sont des accumulations de fins cristaux de glace, de gouttelettes d'eau, de poussières. L'air atmosphérique est, en permanence, le siège de turbulences, de brassages violents d'où naissent les vents. Même par temps calme au niveau du sol, les vents agitent les couches atmosphériques plus élevées et provoquent le déplacement des nuages, selon des vitesses et des directions variables. |
| Les nuages
sont faits de légères gouttelettes d'eau qui parfois se rassemblent en gouttes
plus grosses. Quand les gouttes d'eau deviennent trop lourdes pour être
portées par l'air, elle tombent... et il pleut.
La surface des mers, des fleuves, des marécages est en perpétuel état d'évaporation, particulièrement intense lorsqu'il fait chaud. Ces fines particules de vapeur d'eau, mélangées à l'air, en s'élevant rencontrent des couches d'air plus froides. Elles se condensent sous l'aspect de gouttes de grosseur variable qui forment les nuages. Quand les gouttes sont suffisamment lourdes le nuages crève, et la pluie tombe avec une vitesse qui dépend du volume des gouttes. |
|
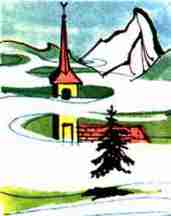 |
C'est un épais nuage
flottant au ras du sol qui enveloppe tout et empêche de voir loin. Il est
fait de très nombreuses petites gouttelettes d'eau qui emprisonnent parfois
les fumées et les poussières.
Toutes les eaux de surface s'évaporent. Le matin, lorsque le soleil n'a pas encore échauffé les couches d'air, ou le soir, au coucher du soleil, la vapeur d'eau se transforme en une nappe de fines gouttelettes, réunies au niveau du sol, qui constituent le brouillard. Celui-ci est vite dissipé dès que la température s'élève. Il ne faut pas le confondre avec la fumée qui, bien souvent, se mélange au brouillard des villes. |
| La lune ne
se cache pas car elle est bien loin au-dessus des nuages. Ce sont les nuages
qui passent entre elle et nous et la cache à nos yeux. Quand ils ont passé
la lune toujours là et elle continue, indifférente, son lent voyage autour
de la terre.
La lune tourne autour de la terre. Les nuages sont souvent poussés par le vent, et se forment dans l'atmosphère, entre la terre et la lune. Le sens du déplacement de la lune et des nuages n'est pas forcément le même, et la vitesse de leurs mouvements respectif est différente. Aussi la lune les nuages semblent-ils souvent jouer à cache-cache dans le ciel. |
|
 |
Elle est dans le ciel,
mais on ne la voit pas, quand elle tourne vers nous sa partie dans l'ombre
et non sa partie éclairée. Il se peut aussi qu'un rideau de nuages la cache
à notre vue ou qu'elle ne paraisse qu'au petit matin.
La lune est éclairée par le soleil. Lorsque la lune passe entre le soleil et la terre, la surface de la lune tournée vers notre planète ne reçoit aucun rayon solaire et est invisible. C'est la nouvelle lune. La lune tourne très lentement autour de la terre et semble se lever se chaque jour plus tard que la veille : il arrive qu'elle ne paraisse dans le ciel qu'en fin de nuit, ou qu'elle ne soit visible qu'au début de la nuit. Des nuages peuvent aussi cacher la lune ! |
| Elle ne marche
pas, elle ne nous suit pas. On la voit tout le temps quand on se déplace,
parce qu'elle est très, très loin et très haut, au-dessus de la terre et
qu'elle est très grosse.
La lune est à l'infini par rapport à l'œil de l'observateur. Si on regarde la lune pendant un court moment, la distance qui sépare la lune de l'observateur a varié, mais il angle sous lequel on voit l'astre est sensiblement le même. Une observation prolongée de notre satellite rendrait sensible le déplacement relatif de la lune par rapport à l'observateur. Au cours d'une promenade, tout semble se passer comme si la lune suivait l'observateur. |
|
 |
Quand on voit la lune,
c'est parce qu'elle est éclairée par les rayons du soleil. Mais il arrive
que le soleil, selon sa place dans le ciel, ne puisse éclairer qu'une partie
de la lune. Le reste est dans l'ombre.
De la terre, on ne voit qu'une face de la lune, toujours la même, et dont la forme dépend de la distance angulaire soleil-lune. Pendant le premier quartier, elle présente un croissant effilé dont les pointes sont tournées à l'opposé du soleil ; pendant la pleine lune, le disque est visible toute la nuit, la lune est ronde ; puis c'est le dernier quartier dont les pointes du croissant sont tournées vers le soleil. |
 |
Les étoiles sont des
soleils qui brûlent comme le nôtre et produisent comme lui de la chaleur
et de la lumière. Mais comme elles sont très loin, bien plus loin que notre
soleil, elle nous paraissent toutes petites et on ne voit que leur lumière.
Les étoiles sont énormes masses gazeuses, où domine l'hydrogène, et au sein desquels règne une grande activité atomique. Les atomes s'entrechoquent perpétuellement, et cette gigantesque agitation est génératrice de chaleur de lumière. Les étoiles émettent donc des radiations lumineuse qui mettent des millions d'années-lumière à nous parvenir, mais que nous percevons cependant, malgré la distance qui nous sépare. |
| Il y a tout
le temps des étoiles dans le ciel ; mais on ne les voit pas, car la lumière
du soleil et plus forte que la leur et les étoiles sont moins brillantes
que lui.
Les étoiles sont lumineuses par elles-mêmes, comme le soleil qui est l'étoile la plus proche de notre planète. Elles sont à des distances énormes de la terre, à des milliards de kilomètres. Pendant le jour, la lumière qu'elles envoient est masquée par celle du soleil. La nuit, pour la région de la terre qui se trouve dans l'ombre, il devient possible de percevoir leur éclat. |
|
 |
La lumière qui vient
du soleil est formée du mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
L'air qui entoure la terre filtre la lumière mais laisse passer davantage
les rayons bleus.
La lumière du soleil est faite de la juxtaposition de radiations colorées qui, en traversant les couches de l'atmosphère, perdent plus ou moins de leur énergie. Elles sont absorbées. Cette absorption est moins rapide pour les radiations bleues, qui pénètrent plus profondément dans l'air. En même temps, elles sont diffusées, éparpillés dans toutes les directions par les particules gazeuses, la vapeur d'eau, les poussières. Notre atmosphère prend alors une coloration bleue. |
| On appelle
« ciel » l'air qui se trouve au-dessus de nos têtes. En réalité, l'air nous
entoure et touche la terre et la mer. Mais, comme toutes les choses éloignées,
la mer, les nuages et le ciel semblent se rejoindre à l'horizon.
Lorsqu'on observe le ciel, on a l'illusion d'être le centre d'une demi-sphère, faite du ciel lui-même. La terre semble limitée, à l'horizon, par un cercle dont le centre est aussi l'observateur. Au bord de la mer, la surface balayée par l'œil rencontre peu d'obstacles. L'intersection de la sphère céleste imaginaire et du globe terrestre paraît réalisée : on croit voir le ciel toucher la mer. |
|
 |
Le ciel contient des
millions d'astres, de soleils, de planètes qui sont souvent plus gros que
notre énorme terre. De loin, ils s'attirent et se repoussent les uns les
autres, si bien qu'ils restent en équilibre. La terre semble flotter dans
l'espace.
On sait que la terre attire les corps. Le soleil, lui aussi, attire la terre avec une puissante gravité. Mais la terre tourne autour du soleil et, de se fait, une autre force, la force centrifuge, tend à l'éloigner du soleil, comme l'essoreuse centrifuge de la machine à laver rejette l'eau hors du linge. Ces deux forces, l'une qui attire la terre vers le soleil, l'autre qu'il en éloigne, s'équilibrent et expliquent que notre planète se trouve maintenue dans le ciel sur une même orbite. |
| Les avions
volent très haut dans la couche d'air qui entoure la terre. Les satellites
circulent plus haut dans l'espace qui ne contient pas d'air. Plus loin encore,
les étoiles se trouvent à des milliards de kilomètres. Personne ne connaît
les limites du ciel.
Il n'y a pas de « côté » dans le ciel. La terre et les huit autres planètes qui gravitent autour du soleil, sont entourées de milliards étoiles, séparées les unes des autres par des distances énormes et dont l'ensemble constitue la galaxie dont faite partie La Voie Lactée. L'univers est d'une telle immensité, qu'il est meublé par d'autres galaxies que séparent des océans d'espace, et que les télescopes de plus en plus puissants, permettent de déceler. L'univers n'a pas de limite. |
|
 |
On a lancé les satellites
avec tellement de puissance qu'ils ont pu aller très, très loin au-dessus
de la terre, dans une région où ils ne sont plus attirés par cette force
venant du centre de la terre et qu'on appelle la « pesanteur ».
Lorsqu'un satellite tourne autour de la terre, à une altitude déterminé, c'est qu'il y a équilibre entre l'attraction de la terre exercée sur le satellite, et une autre force, égale et opposée. Cette force, c'est la force centrifuge, engendrée par la vitesse imprimée au satellite dans son mouvement de révolution autour de la terre, et qui l'empêche le tomber. |
| Ils volent
grâce à leur forme et à la puissance de leur moteur. Leurs ailes s'appuient
sur l'air tandis que leurs hélices, en tournant très vite, les tirent dans
l'air, ou que leur moteur à réaction les pousse avec force.
Dès que l'avion prend de la vitesse sur la piste, l'air exerce sur le fuselage et surtout sur les ailes, des forces de résistance complexes. La résistance de l'air peut-être décomposé en deux forces composantes, la portance ou poussée qui tend à soulever l'avion et la traînée qui s'oppose au mouvement. Au décollage, la vitesse doit être suffisante pour que la portance soit supérieure au poids de l'avion. En vol horizontal, à vitesse constante, la portance équilibre le poids total et c'est l'énergie libérée par les moteurs qui vainct la traînée. |
|
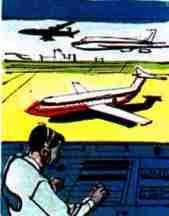 |
Les avions, dans le ciel,
sont dirigés par le pilote qui peut consulter des cartes, suivre une direction
précise grâce à une boussole, se renseigner par radio, ou bien, tout simplement,
reconnaître le paysage.
La tour de contrôle de l'aérodrome donne au pilote l'autorisation de décoller et surveiller la marche de l'avion sur un rayon de 9 km. Ensuite, l'appareil est sous la servitude des centres de contrôle régionaux qui réalisent un véritable quadrillage du ciel. Sur les grands itinéraires, il existe des « air-ways », véritables routes du ciel. Divers systèmes, utilisant les ondes électromagnétiques, guident les avions. Des accéléromètres signalent automatiquement les variations d'altitude, de vitesse, de route, et permettent au pilote de corriger le vol. |
| Avant de
pouvoir atterrir, les avions tournent au-dessus du terrain pour attendre
leur tour, pour perdre de la hauteur, pour aborder la piste dans la direction
d'où vient le vent, ou pour recevoir les ordres que leur donne la tour de
contrôle.
Étant donné la densité du trafic sur un grand aérodrome, aucun appareil ne peut atterrir, sans avoir donné son indicatif et reçu des ordres très précis, par les régulateurs de la tour de contrôle. Radio et radar guident l'avion, lui communiquant l'altitude à tenir, le numéro de la piste en service, celui de l'ordre d'atterrissage. Il est fréquent devoir tourner au-dessus du terrain plusieurs avions, attendant leur tour d'arrivée en piste, surtout quand la visibilité et mauvaise. |
|
 |
De grosses roues (ou
train d'atterrissage) permettent aux avions de rouler. Lorsqu'on remplace
ces roues par des flotteurs, ou lorsqu'on transforme la carlingue en coque
de bateau, l'avion peut glisser sur l'eau : on l'appelle alors hydravion.
Les hydravions sont équipés de flotteurs et d'une coque spécialement étudiée pour pouvoir décoller ou se poser sur un plan d'eau. En prenant de la vitesse, les actions simultanées de l'eau et de l'air permettent à l'hydravion de se soulever en partie et de ne plus reposer sur l'eau que par les arêtes des redans ménagés sur la coque : c'est le déjaugeage. Lorsque la vitesse augmente suffisamment, l'appareil s'élève et se maintient sur les couches d'air par la sustentation des ailes. |
| Certains
avions très rapides dépassent la vitesse du son. Lorsqu'ils atteignent cette
vitesse, il se produit un grand bruit dans le ciel qui se répercute jusqu'à
nous et fait trembler les vitres. L'avion vient de franchir « le mur du
son ».
L'aile d'un avion comprime l'air devant elle qui ; la pression ainsi créée, varie avec la vitesse de l'avion, et produit des ondes sphériques qui deviennent tangentes entre elles intérieurement quand l'avion atteint la vitesse du son. L'avion qui va franchir ce « mur du son » est soumis à des efforts énormes, car il est placé dans une accumulation d'énergie considérable. C'est à ce moment que ce produit le « bang », véritable paquet d'énergie vibratoire, comparable à un coup de canon et capable de briser des vitres. |
|
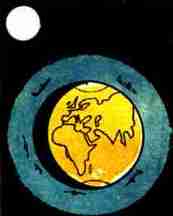 |
L'avion n'a ni la forme
ni la puissance lui permettant de s'éloigner assez de la terre. Des fusées
pourront y aller parce que sont construites spécialement pour cela.
Depuis toujours l'homme a rêvé d'imiter les oiseaux qui volent en prenant appui sur l'air. Leurs ailes sont à la fois le moteur qui fait avancer et les plans qui portent. Les avions ont, eux, un moteur et des ailes. Mais ils ne peuvent dépasser l'altitude où l'air se fait si rare qu'ils ne les porte plus. Au-dessus de 10 à 15 kilomètres, l'avion moderne plafonne : voilà pourquoi il ne peut aller dans la lune. Mais la fusée, avec ou sans ailes, grâce à sa forme, à son moteur à réaction, est faite pour se déplacer là où il n'y a plus d'air. |
| C'est la
grande hélice située au-dessus de l'appareil qui, en tournant vite, le soulève
de terre et le porte. En réglant la vitesse de cette hélice géante, on peut
arriver à maintenir l'hélicoptère immobile dans l'air.
Au-dessus de l'hélicoptère, un rotor, muni de pales à pas variable, crée, par sa rotation, une force aérodynamique de sustentation. Pour décoller à la verticale, il faut que la force ainsi créée, soit supérieure au poids de l'hélicoptère. Ensuite, si on réduit la vitesse de rotation du rotor, pour que la force soit égale au poids de l'appareil, le vol est stationnaire. L'inclinaison convenable du rotor vers l'avant, ou latéralement, permet un vol translationnel. L'hélice de queue empêche l'appareil de tourner sur lui-même. |
|
 |
Le parachutiste saute,
ayant sur son dos un grand parachute bien plié et bien attaché à sa ceinture.
Pour que la parachute s'ouvre, il faut que l'air s'engouffre dans la toile,
et la déplie. La parachute porte alors l'aviateur, dont la chute se trouve
très ralentie.
L'ouverture du parachute peut se faire mécaniquement à partir de l'avion. Un filin d'acier, tendu à l'intérieur de l'avion, permet d'accrocher un mousqueton lié lui-même a une sangle d'ouverture automatique, fixée au parachute. Lorsque le parachutiste saute, le poids de son corps tend la sangle et permet le déploiement du parachute. Le parachute ventral est à ouverture commandée par le parachutiste lui-même qui tire sur une poignée, arrachant une cheville et libérant la parachute. |
| Bien que
la surface du parachute ralentisse la descente, le parachutiste risquerait
de se blesser s'il n'avait pas été entraîné pendant plusieurs mois à répéter
les mouvements qu'il doit exécuter au cours de la descente et de l'arrivée
au sol.
Lorsque le parachute est ouvert, la surface déployée offre une grande résistance à l'air. La vitesse de la chute et considérablement ralentie. Ainsi pour un poids de 100 kilos, la vitesse en chute libre étant de 31 mètres seconde, tombe, avec le parachute, à 4 mètres seconde. De plus, le parachutiste a étudié les positions à donner à son corps au moment de l'atterrissage, pour minimiser les risques d'un traumatisme. |
|